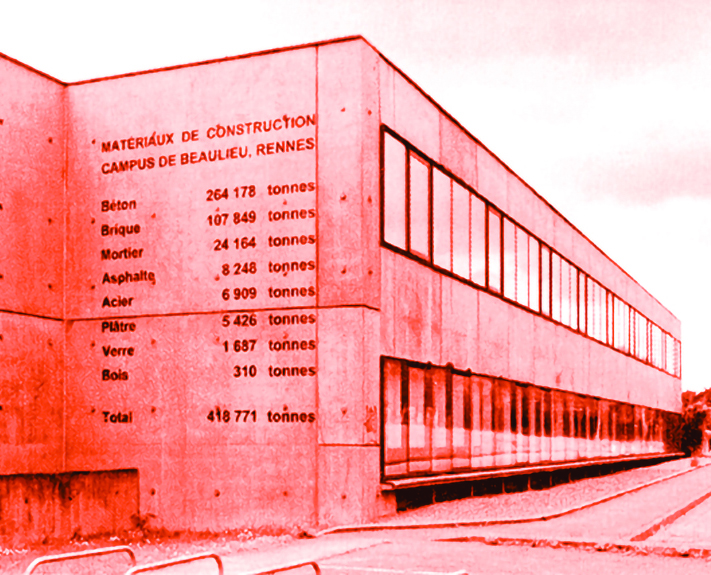Le patrimoine est un ensemble existant, souvent en grande partie ou en totalité hérité du passé, constitué de biens matériels et/ou immatériels, propriété privée ou bien commun, que l'on peut vouloir conserver, valoriser ou maintenir pour les générations futures. Il est le reflet de la façon dont une société donnée se représente son propre passé et son avenir, à travers ce qu'elle estime vouloir transmettre. Ce qui qualifie ce patrimoine et en détermine la valeur, tout autant que les modalités et les moyens de sa transmission, relève souvent de considérations politiques, économiques et sociales.
À partir d’une enquête de terrain portée sur la transmission du patrimoine industriel et culturel d’une commune française, Épernon, ce travail de recherche-création en Art et Design s'intéresse précisément aux critères, aux modalités et aux formes de cette transmission. Proposant une critique des phénomènes de patrimonialisation et de muséification, qui tendraient à figer une mémoire fragmentée et incomplète de nos héritages et de notre Histoire, ce travail cherche à rendre compte d’approches alternatives aux postures de transmission tournées vers la conservation.
En effet, selon nous, les approches tournées vers la conservation ou la réhabilitation « d’objets de patrimoine » négligent trop souvent les dimensions culturelles, expérientielles et les savoirs pratiques qui entourent ces objets. Ainsi cette transmission s’avère partielle, et limite sa réappropriation par les générations futures. Dès lors, de quelle manière réactiver ce qui fait patrimoine aujourd’hui, dans toutes ses dimensions et en tant qu’héritage vivant ? Comment proposer davantage de prises à sa réappropriation ?
Dans ce contexte, la démarche de recherche en design développée ici tente d’ouvrir une réflexion et proposer des chantiers dédiés à la reprise des savoirs à l'ère post-industrielle. Par l'idée de « reprise de savoirs », il s'agit d'une part de prendre en considération de tels héritages comme support de nouvelles pratiques et cultures techniques. Ce mémoire s’attache donc à rendre compte et formaliser ce qui fait patrimoine, à travers un travail d’enquête et d’analyse, mais également de documentation et d’archivage prenant la forme d’une boîte à outils en ligne. En dialogue avec les institutions et organisations existantes, il s’agit de participer de la réinvention de cadres de transmission reliés aux formes d'éducation et d'écologies populaires en prise avec les territoires. D'autre part, ce travail cherche à réaffirmer, par le design et dans la continuité des travaux de Marx ou de Stiegler, la perspective et l'enjeu d'une déprolétarisation généralisée de la société au sein de laquelle les
habitants (producteurs, consommateurs, concepteurs) seraient à même de penser et de prendre part activement aux transformations de leur territoire de vie.
Épernon et
son industrie
Épernon, cette commune où j’ai grandi. Épernon, ce territoire rural. Épernon, cette ville endormie. Mais Épernon, cette cité habitée par une histoire industrielle forte de savoir-faire aujourd’hui perdus. Cette histoire mérite d’être racontée. À partir du milieu du XVIIIe siècle, de nombreuses carrières de grès furent découvertes à Épernon et ses alentours. L’exploitation de ces ressources engendra de grandes transformations sur le territoire, au niveau économique ou encore démographique. Ces savoir-faire, liés au travail de la pierre, furent reconnus au-delà des frontières, offrant à Épernon une renommée inattendue. Cependant, de nouveaux bouleversements techniques et sociaux sonnèrent le glas de cet âge d’or, un siècle plus tard. La désindustrialisation ébranla Épernon, et les savoirs de la pierre disparurent à défaut de se renouveler, plongeant à nouveau ce territoire dans l’anonymat.
Réactiver un patrimoine
En 2005, la municipalité d’Épernon, commune d’Eure-et-Loir, souhaita revaloriser l’héritage industriel et culturel propre à son territoire et lié à l'exploitation de la pierre. Fut érigé un conservatoire rassemblant et abritant les composantes de ce patrimoine:pierres de meules, pavés, outils, archives… La démarche de sauvegarde, d’entretien, d’exposition et de médiation autour des savoirs de la pierre incarne une forme de patrimonialisation permettant d’inscrire cet héritage dans la mémoire collective. Néanmoins, au regard des transformations systémiques produites par la désindustrialisation sur nos territoires, de telles démarches de conservation sont-elles les seules manières d'hériter de notre Histoire collective ? Sont-elles pertinentes, et sont-elles suffisantes pour engager une mutation collective des formes de vie, de travail et de citoyenneté sur nos territoires ? Pourrait-on envisager d’autres formes de socialisation de la technique, remobilisant ces savoirs comme participants d’une émancipation collective ? Pourrait-on parler ici d’un design de nos existences, qui en recomposant ensemble les formes de savoirs - savoir penser, savoir faire, savoir vivre - tendrait à ouvrir la voie vers un investissement commun pour une société aujourd’hui trop fragmentée ?